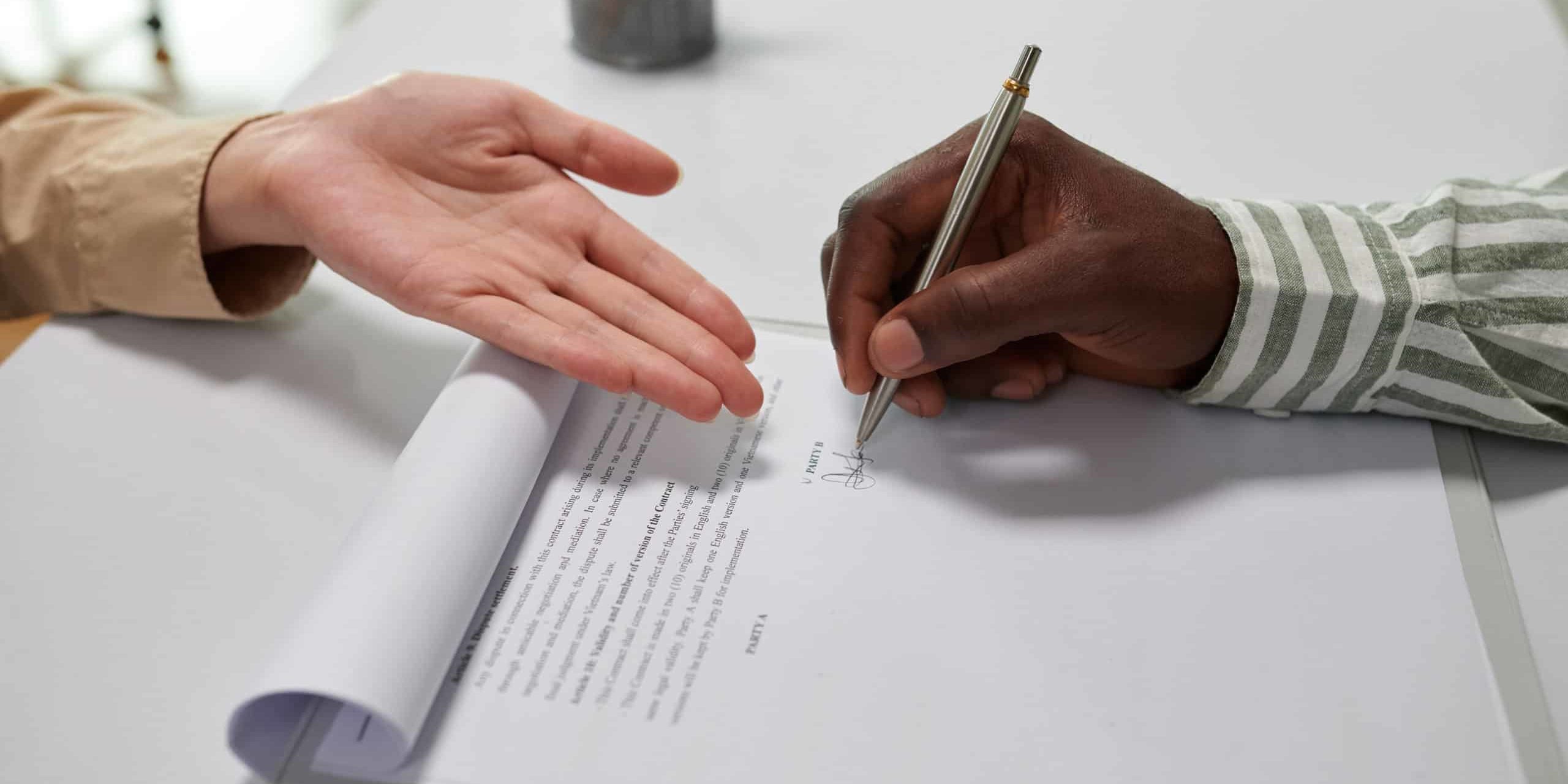En droit civil, la responsabilité délictuelle envers les tiers suscite depuis longtemps des débats, notamment face au principe de l’effet relatif des conventions, qui paraissait interdire toute action fondée sur un contrat auquel les tiers n’étaient pas parties.
L’effet relatif des contrats est un principe fondamental du droit des obligations qui signifie qu’un contrat ne produit d’effets qu’entre les parties qui l’ont signé. Autrement dit, seuls les signataires du contrat (appelés cocontractants) sont tenus par les obligations du contrat et peuvent en bénéficier, tandis que les tiers (personnes qui ne sont pas parties au contrat) ne peuvent ni exiger l’exécution du contrat, ni y être contraints. Ce principe est inscrit à l’article 1199 du Code civil. Pourtant, la pratique a révélé des cas récurrents où un tiers subit directement un dommage en raison d’un manquement contractuel (fabrication défectueuse, construction mal exécutée, etc.).
La jurisprudence a donc ouvert aux tiers un droit à réparation sur le terrain délictuel, en considérant que l’inexécution contractuelle peut constituer une faute délictuelle lorsqu’elle leur cause un dommage. Ce mouvement initié par un arrêt célèbre rendu par la Cour de cassation, dit « Boot Shop » (Ass. Plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255).
Cet arrêt a été rendu dans une affaire où la société Myr’Ho était locataire d’un immeuble commercial et avait confié la gestion de son fonds de commerce à la société Boot Shop, qui a attaqué les bailleurs pour défaut d’entretien des locaux.
La Cour de cassation a alors décidé pour la première fois que le tiers à un contrat pouvait invoquer un manquement contractuel d’une des parties au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage, même s’il n’est pas partie au contrat. Cette décision a eu un impact majeur sur le droit de la responsabilité civile.
Cet arrêt très important a été consolidé par un arrêt dit des « Sucreries de Bois Rouge » (Ass. Plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963). Ce deuxième arrêt a ainsi confirmé que la responsabilité délictuelle du cocontractant à l’égard des tiers, sans que le tiers ait à prouver une faute distincte, étendant la protection des tiers-victimes des inexécutions contractuelles.
Cette jurisprudence est aujourd’hui affinée par l’arrêt Clamageran (Com. 3 juill. 2024, n°21-14.947).
Dans cette décision, la Cour de cassation confirme l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, mais apporte une correction de taille : le contractant défaillant peut désormais opposer au tiers victime les conditions et limites de responsabilité prévues dans son contrat. Ce tournant vise à rééquilibrer les rapports entre tiers et contractants, mais soulève d’importantes incertitudes théoriques.
I – Responsabilité délictuelle envers les tiers : confirmation du principe d’identité des fautes
A – Un choix politique au profit de la réparation
L’arrêt Boot Shop a posé un principe simple, mais révolutionnaire : le manquement contractuel suffit à engager la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant envers un tiers. Ainsi, plus besoin pour la victime d’identifier une faute de prudence ou de diligence distincte du contrat. La Cour de cassation assume un choix de politique jurisprudentielle visant à ne pas entraver l’indemnisation du dommage et préserver les intérêts des victimes d’une défaillance contractuelle, dès lors que « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers » lui causant un préjudice.
B – Les justifications techniques : l’opposabilité normative du contrat
Pour légitimer cette assimilation, certains auteurs invoquent l’opposabilité du contrat par les tiers. Le contrat, en tant qu’acte juridique, rayonne au-delà des parties et peut constituer un standard de comportement. Ainsi compris comme norme privée, son inexécution serait illicite erga omnes, et donc assimilable à une faute délictuelle.
II – L’arrêt Clamageran et la responsabilité délictuelle envers les tiers : continuité et innovation
A – Une confirmation de l’unité des fautes
Au terme de cet arrêt Clamageran de 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme que le manquement contractuel équivaut à une faute civile à l’égard des tiers. Elle confirme également que l’action du tiers est nécessairement extracontractuelle puisque le tiers n’est lié par aucun lien contractuel.
B – Une innovation : les conditions et limites contractuelles opposables au tiers
La nouveauté majeure réside dans l’opposabilité aux tiers des « conditions et limites » de responsabilité prévues entre contractants.
Cela inclut :
- les clauses limitatives ou exonératoires,
- la limitation légale aux dommages prévisibles (1150 ancien du Code civil),
- et plus largement l’économie contractuelle de l’obligation.
En d’autres termes, le tiers ne peut plus obtenir du débiteur défaillant plus que n’aurait obtenu son créancier initial. Cette symétrie corrige la critique faite à l’arrêt Boot Shop, qui semblait offrir aux tiers une protection plus généreuse qu’aux parties au contrat.
C – Un fondement technique et politique
La Cour de cassation rend sa décision sous le visa des articles 1134, 1165 et 1382 anciens. Elle invoque la force obligatoire du contrat, non pour fermer l’action, mais pour justifier que les clauses contractuelles s’imposent aussi au tiers.
Politiquement, il s’agit d’un balancier jurisprudentiel : après avoir favorisé l’indemnisation des tiers en 2006–2020, la Cour prend en compte l’intérêt du débiteur, qui doit pouvoir compter sur les prévisions contractuelles ayant guidé son engagement.
Vous avez subi un dommage causé par l’inexécution d’un contrat auquel vous n’étiez pas partie ?
Nos avocats évaluent si la responsabilité délictuelle peut être engagée.
III – Une doctrine toujours divisée sur la responsabilité délictuelle du contractant envers les tiers
La doctrine continue de contester le principe même de l’assimilation, jugé attentatoire à l’autonomie de la volonté et à la force obligatoire. Permettre au tiers d’invoquer la faute contractuelle revient presque à lui accorder un bénéfice du contrat, ce qui n’est pas faux.
Certains auteurs plaident pour renverser la logique : le tiers pourrait, à titre exceptionnel et s’il démontre un intérêt légitime à l’exécution du contrat, engager la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant. Cette polémique n’a pas beaucoup de sens pour nous, car l’intérêt légitime du tiers à l’exécution du contrat résulte tout simplement du préjudice qu’il invoque. Il serait plus utile de limiter la responsabilité du cocontractant défaillant à la protection de l’intérêt prévisible du tiers que le cocontractant devait ou aurait dû préserver.
IV – Les effets pratiques et limites de la responsabilité délictuelle envers les tiers
L’action devient une construction hybride, délictuelle par sa forme, mais contractuelle par ses effets. Il est difficile d’appliquer les limites contractuelles à une action délictuelle.
Si la solution protège légitimement le cocontractant défaillant, elle expose le tiers qui pourrait subir les effets et limites des clauses contractuelles sans en avoir eu connaissance ni pouvoir les discuter, limitant dès lors son indemnisation, ce qui est contraire au principe de l’entière indemnisation du préjudice en matière délictuelle, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil comme du nouvel article 1240 du même code. Mais peut-on critiquer cela sans créer une injustice au détriment du cocontractant qui n’a pas défailli, qui aurait moins de droit que le tiers dans l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Certes, l’arrêt Clamageran vient corriger une critique majeure : l’avantage indu dont bénéficiait le tiers par rapport au cocontractant non défaillant. Mais elle fragilise davantage la cohérence du droit français de la responsabilité civile, en créant une action hybride aux frontières brouillées entre contrat et délit.
Conseils pratiques
Le principe de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle doit vous conduire à bien réfléchir avant d’engager votre action. En outre, les règles de procédure et de prescription ne sont pas les mêmes selon les responsabilités encourues.
Ces jurisprudences engageant la responsabilité délictuelle d’une partie défaillante au contrat vis-à-vis des tiers, ne s’appliquent pas dans tous les cas. Les commentateurs oublient souvent de préciser son domaine d’application.
La responsabilité du cocontractant défaillant, telle qu’établie en droit français, ne s’applique pas aux salariés ni à certains autres cas d’exclusion. En effet, la relation contractuelle entre employeur et salarié est encadrée par un régime spécifique, régissant essentiellement les obligations de travail et la protection sociale, ce qui exclut l’application directe de la responsabilité contractuelle classique du cocontractant défaillant. Ainsi, si un salarié n’exécute pas convenablement ses obligations, vous ne pouvez pas engager directement sa responsabilité civile, sur le fondement de cette construction jurisprudentielle. Sauf à démontrer une faute détachable de ses fonctions.
Par ailleurs, cette responsabilité contractuelle repose sur l’existence d’un contrat entre les parties et oblige le débiteur à réparer les manquements à ses obligations envers son cocontractant. Or, les salariés ne sont pas considérés comme des cocontractants dans cette construction juridique. Vous aurez relevé que là, c’est la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui s’est positionnée sur cette question et non la Chambre sociale qui traite des litiges entre employeur et salarié.
De plus, la jurisprudence et la doctrine précisent plusieurs cas où la responsabilité du cocontractant défaillant ne s’applique pas, notamment dans les situations dans lesquelles la relation juridique n’est pas directement contractuelle ou en présence de contrats spécifiques soumis à des règles particulières, comme en matière administrative.
Nos avocats vous accompagnent pour évaluer la responsabilité délictuelle et défendre vos droits devant les juridictions compétentes.
Planifiez un échange confidentiel avec notre équipe.
👉 Contactez-nous dès maintenant pour une consultation personnalisée.
❓ FAQ — Responsabilité délictuelle du contractant envers les tiers
Qu’est-ce que la responsabilité délictuelle envers les tiers ?
La responsabilité délictuelle envers les tiers désigne le droit pour une personne qui n’est pas partie à un contrat (le tiers) d’agir contre un cocontractant lorsque l’inexécution du contrat lui cause un dommage.
Autrement dit, même sans lien contractuel, le tiers peut demander réparation sur le fondement de la faute civile (article 1240 du Code civil).
Quelle est la différence entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle ?
La responsabilité contractuelle découle du non-respect d’un contrat entre les parties signataires, tandis que la responsabilité délictuelle sanctionne un comportement fautif en dehors de tout contrat.
Dans le cas du tiers victime, seule la responsabilité délictuelle peut être invoquée, car il n’existe aucun contrat le liant au cocontractant fautif.
Que change l’arrêt Clamageran rendu par la Cour de cassation en 2024 ?
L’arrêt Clamageran (Com., 3 juill. 2024, n°21-14.947) marque un tournant : il confirme que la faute contractuelle peut être invoquée par un tiers, mais le contractant fautif peut désormais opposer au tiers les clauses et limites de responsabilité prévues dans le contrat initial (clauses limitatives, plafonds, exclusions, etc.).
Cette solution vise à rétablir un équilibre entre la protection du tiers et la sécurité juridique du contractant.
Quelle est la portée des arrêts Boot Shop et Sucreries de Bois Rouge ?
Ces arrêts majeurs ont consacré la possibilité pour un tiers de se fonder sur une inexécution contractuelle pour obtenir réparation :
-
Boot Shop (Ass. plén., 6 oct. 2006) : reconnaissance de la faute contractuelle comme faute délictuelle envers les tiers.
-
Sucreries de Bois Rouge (Ass. plén., 13 janv. 2020) : confirmation de cette solution et renforcement du droit à réparation des tiers victimes.
L’arrêt Clamageran (2024) vient nuancer cette jurisprudence en introduisant des limites opposables au tiers.
Un salarié ou un prestataire peuvent-ils invoquer la responsabilité délictuelle du cocontractant ?
Pas toujours.
Le salarié relève d’un régime spécifique (droit du travail), distinct du droit commun des obligations.
Sauf faute détachable des fonctions, la responsabilité délictuelle du cocontractant ne peut pas être invoquée contre un salarié.
En revanche, un prestataire indépendant ou un partenaire commercial peuvent agir en responsabilité délictuelle s’ils prouvent un préjudice direct causé par l’inexécution d’un contrat auquel ils ne sont pas parties.
Quels sont les délais pour agir en responsabilité délictuelle ?
Le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage (article 2224 du Code civil).
Ce délai diffère de la prescription contractuelle, souvent plus courte, d’où l’importance de choisir le bon fondement d’action avant d’engager une procédure.
Comment savoir si j’ai intérêt à agir sur le fondement délictuel ?
Tout dépend :
-
Si vous n’êtes pas partie au contrat, la voie délictuelle est en principe la seule ouverte.
-
Si vous êtes cocontractant, vous devez en général agir sur le terrain contractuel, sauf faute détachable du contrat.
L’analyse de votre situation nécessite un examen précis du contrat, du préjudice et du lien de causalité.
Pourquoi cette question est-elle cruciale pour les entreprises ?
Parce que de nombreuses entreprises subissent un préjudice économique ou matériel indirect du fait d’un contrat passé entre deux autres parties (sous-traitance, livraisons défaillantes, ruptures de chaînes logistiques…).
Comprendre les contours de la responsabilité délictuelle envers les tiers permet de mieux anticiper les risques juridiques, rédiger des contrats protecteurs et agir efficacement en cas de dommage.